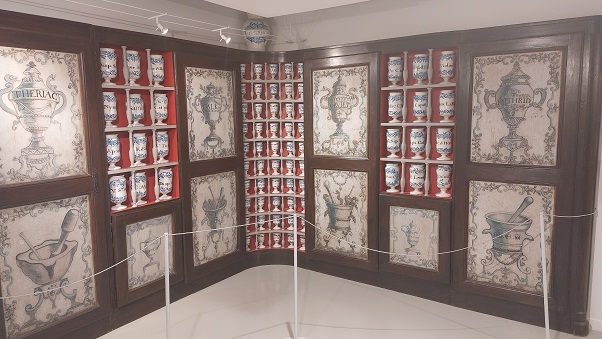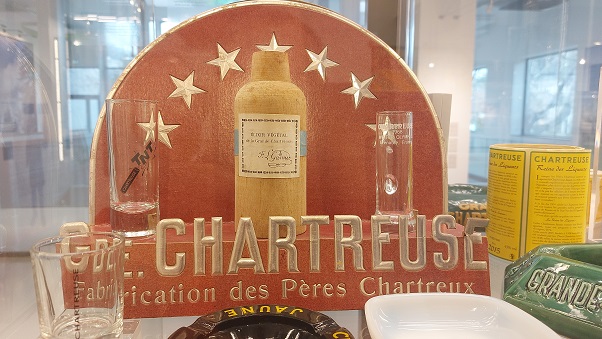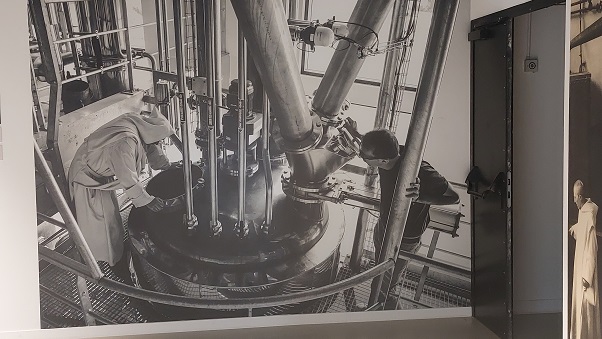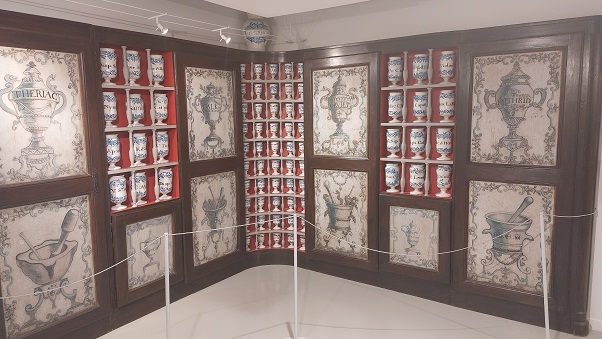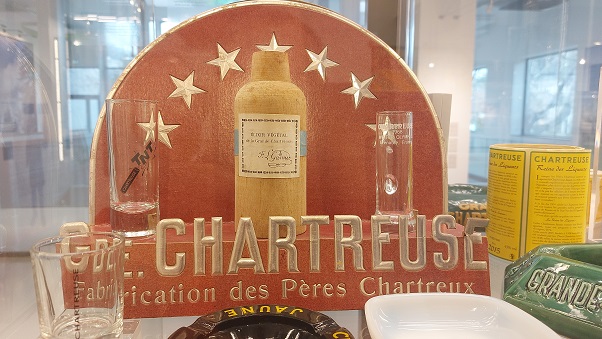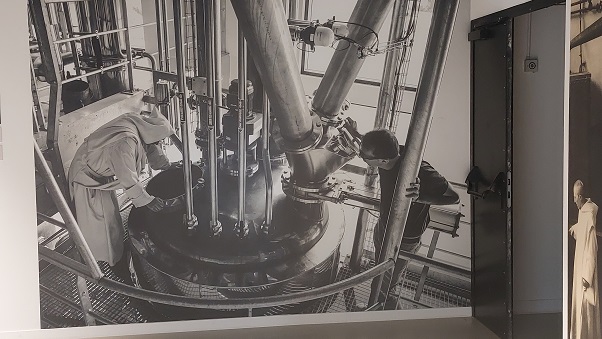Caves de
la Chartreuse à Voiron (38)
- Les liqueurs Chartreuse tiennent leur nom de l'Ordre des
chartreux, qui tire le sien d'un lieu où Bruno et ses
six compagnons décidèrent de s'installer en 1084 : le
"désert" de Chartreuse. Ils érigent un
monastère dans ces montagnes pour y vivre en prières et
contemplation. Autosuffisants, ils trouvent des moyens de
subsistance dans leur environnement proche : élevage,
pêche, exploitation des forêts, maîtres de forges. D'autres
monastères suivant la même règle voient le jour en
Europe. Saint Louis demande aux moines de fonder un
monastère à Vauvert, en lisière de la capitale. La
"Chartreuse de Paris" est entourée de jardins
et de pépinières qui favorisent l'intérêt des moines
pour l'art de la pharmacopée. Ils rencontrent le
médecin et théologien Arnaud de Villeneuve et son
élève Raimond Lulle qui sont célèbres pour leurs
études sur les plantes médecinales. Les moines mettent
alors au point plusieurs élixirs de jouvence, appelés
eaux-de-vie, qui sont utilisés pour leurs vertus
thérapeutiques. En 1616, une apothicairerie est
construite à Vauvert mais les moines n'arrivent pas à
trouver l'équilibre parfait pour leur élixir. En 1737,
le manuscrit sur lequel figure la recette de l'élixir
est transféré à la Grande Chartreuse. Frère Bruno et
frère André vont alors développer une nouvelle formule.
A leur mort, frère Jérôme Maubec parvient, en 1755, au
résultat final avec un remède à 71°. Frère Antoine
Dupuy améliore la formule et le produit obtenu n'est
plus rouge mais un peu verdâtre. En 1764, le procédé
et ses sept opérations successives font l'objet d'un
nouveau manuscrit "Composition de l'Elixir de
Chartreuse". A la fin du XVIIIème siècle, l'élixir
est proposé sur les marché de Grenoble et de Chambéry
et chez quelques dépositaires locaux. La Révolution
française de 1789 sonne le glas de la production. En
1792, les moines sont chassés de la Grande Chartreuse et
de tous les sites qu'ils occupent en France. Le manuscrit
passe de main en main. En 1800, Pierre Liotard, ancien
pharmacien de la Chartreuse, le récupère et le garde
précieusement jusqu'en 1835. En 1816, par ordonnance
royale de Louis XVIII, les chartreux sont autorisés à
regagner leur monastère dévasté. Les moines s'emploient
à produire de nouveau l'élixir. A partir de 1825, un
nouvel "Elixir de table ou de santé" est
développé. Cette nouvelle liqueur de 60° a des vertus
médecinales qui aident à lutter contre l'épidémie de
choléra qui frappe la France et l'Europe en 1832. En
1835, les moines récupèrent leur manuscrit contre 3 000
francs auprès de la veuve de Pierre Liotard. En 1838,
une liqueur de Mélisse est mise au point. Elle est de
couleur blanche. Parallèlement, un autre assemblage plus
doux et à la couleur jaune pâle voit le jour. En 1840,
on distingue désormais la Chartreuse Jaune et la
Chartreuse Verte. Leurs ventes deviennent le revenu
principal du monastère. La renommée des liqueurs
grandit rapidement à tel point que les contrefaçons se
multiplient obligeant les moines à conditionner leur
liqueur dans des bouteilles spéciales avec étiquettes
et cachets. En novembre 1852, la marque est déposée. En
1864, la distillerie est transférée à Saint-Laurent-du-Pont
et un lieu d'entrepôt et d'expédition est installlé à
Voiron. En 1902, en raison d'une politique peu favorable
aux ordres monastiques, la production est transférée à
Tarragone en Espagne. Le liquoriste Cursenier récupère
les droits sur la marque et crée la Compagnie Fermière
de la Grande Chartreuse mais la "Liqueur fabriquée
à Tarragone par les Pères Chartreux" est
inimitable. En 1921, les Pères Chartreux ouvrent une
nouvelle distillerie à Marseille ce qui leur permet de
relancer leurs ventes en France. La Compagnie Fermière
fait faillite en 1929. La Compagnie Française de la
Grande Chartreuse, gérée par les moines, récupère sa
marque. Après quatre années de travaux, la production
reprend à Saint-Laurent-du-Pont mais, en 1935, un
glissement de terrain emporte les installations. La
production reprend quelques mois plus tard à Voiron. En
espagne, la guerre civile et le bombardement de la
distillerie en 1938 mettent en difficulté l'activité de
Tarragone. La Seconde Guerre mondiale est une période
difficile et il faut attendre la Libération en 1945 pour
que les ventes reprennent. A partir de 1950, les
chartreux font évoluer l'image de leurs liqueurs et,
grâce à une forte dynamique publicitaire, renouent avec
la croissance. En 1966, les caves de Voiron sont
agrandies pour faire face à la demande. Elles mesurent
164 mètres de long et on se presse pour visiter "la
plus longue cave à liqueurs du monde". Au début
des années 1980, les liqueurs de la Chartreuse
démodées subissent une crise majeure. Les ventes de
Chartreuse Verte s'effondrent. Il faudra deux décennies
aux chartreux pour relever la marque. Les site de
Tarragone est fermé en 1989. En août 2018, la
distillerie d'Aiguenoire est inaugurée au coeur du
massif de la Chartreuse. En 2022, le site des caves de la
Chartreuse à Voiron devient le lieu de culture et d'histoire
de la Chartreuse.
-


-


-
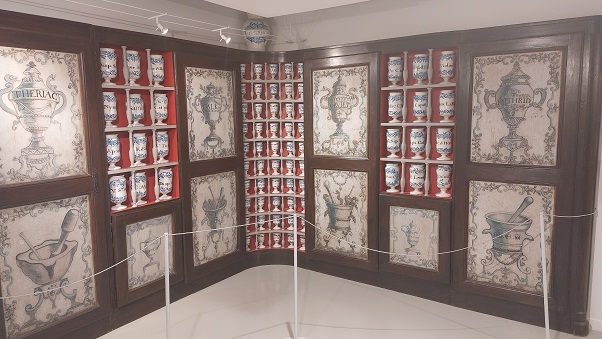

-


-


-

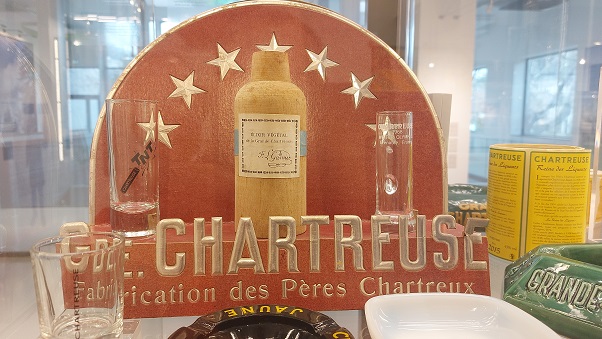
-


-


-

-
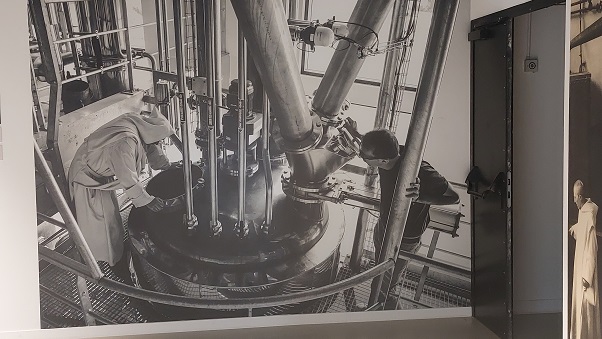
-


-


-

-
- Voiron fut historiquement le siège du comté de
Sermorens, domaine situé au débouché de la cluse de l'Isère,
au pied du massif de la Chartreuse et à l'extrêmité du
diocèse de Vienne. Cette région frontalière entre le
Dauphiné et la Savoie fera l'objet de nombreux conflits
(1150 - 1350) entre les comtes de Savoie et les dauphins
de Viennois. Le Voironnais est rattaché au Dauphiné en
1355 et devient alors définitivement français. Ville
industrielle (chocolaterie, tissages, skis Rossignol
depuis 1907, jouets Gueydon dont est issue l'enseigne
King Jouet) et agricole (côteaux du Grésivaudan), elle
compte aujourd'hui un peu moins de 22 000 habitants.
- L'église Saint-Bruno date du XIXème siècle. C'est un
monument de style néo-gothique s'inspirant des
cathédrales du XIIème siècle.
-
-
-
-
-
-
- La fontaine de la place d'Armes est située face à l'église
Saint-Bruno au pied et fut érigée en 1826 par le maire
Hector Denantes.
-
-
- Mes commentaires:
- Visite assez intéressante qui se termine par une
dégustation de Chartreuse Verte et de Chartreuse Jaune.
Le secret de la liqueur aux 130 plantes est jalousement
conservé au point d'interdire les photographies pendant
la visite du musée et des caves.